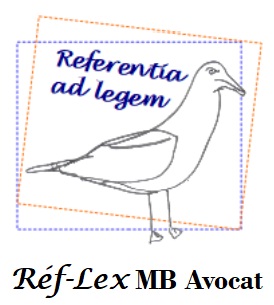France Inter en a parlé.
Matinale du 1er septembre 2025.
Entrée en vigueur de la réforme de l’amiable. Décret du 18 juillet 2025
Extrait :
Quelle configuration pour une conciliation réussie ?
La réforme engagée par le décret du 18 juillet 2025 incite à recourir davantage à la conciliation et à la médiation pour les parties à un litige qui ont déjà saisi l’institution judiciaire.
Pour rappel, j’explique dans le premier épisode de cette série la différence entre conciliation et médiation.
Retenons simplement ici que le conciliateur de justice a la possibilité de proposer aux parties des solutions de résolution amiable, contrairement au médiateur, et que son office est bénévole et gratuit.
Cet article étudie les conditions dans lesquelles une conciliation de justice a de bonne chances de succès.
1. Certains domaines du droit sont plus propices à l’amiable
En effet, certaines matières du droit sont déjà imprégnées par la culture de la négociation. Il en va ainsi par exemple du contentieux contractuel, qu’il s’agisse de contrats privés, civils ou commerciaux, ou de contrats publics. Les cocontractants sont déjà passés par une phase de négociation du contrat avant la signature de celui-ci et ont même pu prévoir des clauses résolutoires ou de responsabilité en cas de différend.
Dès lors, la conciliation qui doit donner lieu dans le meilleur des cas à un accord entre les parties, éventuellement homologué par le juge, n’est qu’un prolongement des relations contractuelles sous le sceau de la négociation, des concessions réciproques et de l’équilibre général de l’économie du contrat.
En revanche, certaines matières sont difficilement compatibles avec l’accord amiable et notamment les procès mettant en jeu les droits fondamentaux ou les libertés publiques.
Par ailleurs, le juge ne peut en aucun cas homologuer un accord contraire à l’ordre public.
2. Les parties souhaitent éviter l’aléa judiciaire
“Mieux vaut un mauvais accord qu’un bon procès”, tel est l’adage bien connu des praticiens des modes amiables.
L’intérêt premier d’une conciliation est de permettre aux parties de décider de la solution qu’elles veulent donner au litige, ce qui permet de mieux maîtriser les risques liés nécessairement à toute action en justice.
Ainsi, l’espace de dialogue ouvert par la conciliation et encadré avec l’appui du conciliateur permet de réduire les incertitudes pour les deux parties.
3. Les parties souhaitent bénéficier de la confidentialité
Le demandeur peut profiter du fait que le défendeur possède dans certains cas un intérêt à éviter une condamnation publique et une atteinte à sa réputation.
En effet, le défendeur peut voir son avantage à accepter de dédommager son poursuivant mais sans reconnaissance de responsabilité dans les faits reprochés, ce que permet parfaitement la conciliation de justice.
4. Les parties souhaitent maîtriser les délais judiciaires
De même, la conciliation peut être un facteur d’accélération des délais de justice, comme j’en ai fait l’expérience en tant qu’avocat.
Les deux parties ont toujours un intérêt à ce que la procédure ne se prolonge pas trop, ne serait-ce qu’en raison des frais de justice que cela implique.
5. Les parties souhaitent se prémunir de l’éventualité d’une voie de recours
Enfin, la conciliation de justice, si elle est couronnée de succès, se conclut par un accord qui met fin au litige.
Cet accord, homologué par le juge vaut titre exécutoire.
Les parties savent dès lors que le contentieux initial ne nécessitera pas de mobiliser des voies de recours telles qu’un procès en appel ou en cassation.
En conclusion, exceptées les affaires complexes touchant aux droits fondamentaux et aux libertés publiques, par exemple, les justiciables ont toujours intérêt à tenter une conciliation au cours de la procédure judiciaire. Cette voie ouverte aux parties ne leur retire pas la possibilité de poursuivre leur procès et de s’en remettre au juge si aucun accord n’est trouvé.